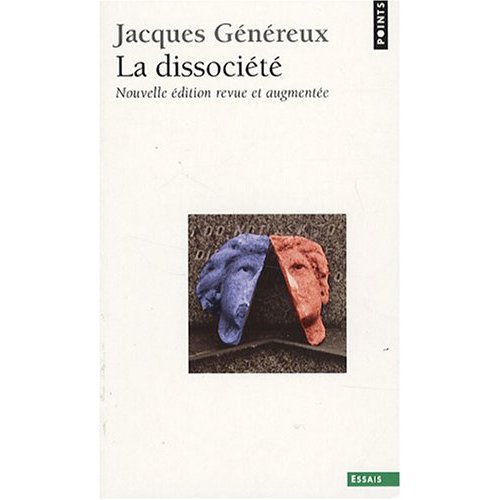Voilà,
enfin, un ouvrage ambitieux. Économiste bien connu et professeur à
Science Po., membre du Conseil national du Parti socialiste, Jacques
Généreux ne propose pas moins qu’une critique anthropologique des
fondements propres au néo-libéralisme contemporain, une analyse des
conséquence de son hégémonie – la restructuration des société de marché
en « dissociétés » - et l’esquisse d’une anthropologie alternative
propre à inspirer un socialisme libéré tant de son fantasme d’une
« hyper-société » collectiviste et productiviste que de la « dérive
néolibérale » de la gauche européenne depuis les année 1980. Une
question, faussement naïve, constitue le fil conducteur de cette
enquête : « Pourquoi et comment des millions d’individus persuadés que
la coopération solidaire est cent fois préférable à la compétition
solitaire restent-ils impuissants à refonder sur elle leur système
économique et politique ? » Généreux suggère à la fois de démontrer la fausseté de
l’anthropologie implicite du néo-libéralisme et de démonter les
ressorts de son emprise pratique sur nos représentations du monde, de
nous-mêmes et d’autrui. A l’évidence, ces deux aspects sont liés. Si le
néolibéralisme nous parle, c’est en raison du fait qu’il est « l’enfant
naturel de tous les discours politiques jumeaux dont a accouché la
modernité ». En ce sens, il y a là moins une « révolution culturelle »
qu’une « involution » de l’individualisme, de l’économisme, du
déterminisme et du productivisme dominants dans les principaux courants
de la pensée moderne. Si le néolibéralisme passe si aisément, c’est
bien qu’il prolonge la conception de la nature humaine et de la société
la plus commune dans la pensée occidentale. Poussant à l’extrême l’idée
moderne de l’individu « rationnel », les néolibéraux identifient
rationalité et égoïsme absolu : l’individu cherche - et calcule -
toujours, partout, uniquement et obsessionnellement son intérêt.
L’entrepreneur, en quête de marché ; l’ami généreux en quête de
reconnaissance ; mais aussi le délinquant, balançant les coûts et
bénéfices de son forfait, ou le RMIste, arbitrant entre la perte de sa
CMU et son retour sur le marché de l’emploi. Cette anthropologie
utilitariste ouvre ainsi à une singulière « histoire naturelle de
l’humanité », justifiant l’état de guerre économique mondial comme une
lutte inévitable entre des êtres non seulement doués pour la
compétition mais naturellement prédateurs et agressifs. Elle justifie
également une étroite conception de la société identifiée à un contrat
d’association utilitaire entre des individus par nature dissociés et
égoïstes. Des individus qui n’ont pas besoin des autres pour être
eux-mêmes mais pour satisfaire leurs intérêts mieux qu’ils ne
pourraient le faire en restant isolés. Bref, non seulement ces
individus auto-suffisants pourraient exister sans lien, mais la société
elle-même ne créerait aucun lien, seulement des connexions dans un
réseau d’échange. Une arithmétique simple régirait ainsi la vie
sociale : ou bien chacun reçoit l’exact équivalent de ce qu’il donne et
c’est là la seule justice - la justice comptable du donnant/donnant - ;
ou bien certains reçoivent plus qu’ils ne donnent, et ceux-là, de
quelque que soient les nom par lesquels on les désigne, sont des
assistés, des parasites. D’où notamment cette rhétorique néolibérale du
« on a rien sans rien » qui vient progressivement substituer le workfare au welfare. La contre-anthropologie que mobilise Généreux avance sur un terrain bien connu et bien balisé par la Revue du MAUSS,
dont il mobilise les travaux, comme ceux de nombreux ethnologues
(Salhins, Hoccart, Polanyi), paléo-anthropologues (J.Cauvin),
psychologues (Damasio, Cyrulnik), éthologues (de Waal) et théoriciens
de l’évolution (Pelt, Picq). Il renoue ainsi avec toute une tradition
intellectuelle que le matérialisme historique marxien avait enterrée et
ridiculisée, avec ce projet d’un fondement indissociablement
anthropologique et moral du socialisme. Projet au cœur de la
« socialo-sociologie » de Marcel Mauss, mais aussi du « socialisme
intégral » de Benoît Malon ou de l’anarchisme de Kropotkine, et avant
eux des socialismes français dits « utopistes » (Saint-Simon et les
saint-simoniens, Leroux, Fourier, Considérant, etc.). Bien-sûr,
affirmer que l’être humain est avant tout un être de relation, voir un
animal sympathique, que l’individuation suppose la socialisation, ou
plutôt l’association donc la coopération, que l’être-soi et
l’être-ensemble sont corrélatifs pourrait certes paraître banal ou même
irénique. Mais tel n’est pas le cas. Si Généreux appuie sa morale
social(ist)e sur une synthèse solide de travaux scientifiques qui font
légitimement autorité, il en explore, ce qui est plus neuf, toutes les
implications pour démonter ces diverses fables du néolibéralisme,
naturalisant tout aussi bien la violence des rapports humains que le
prétendu penchant de l’homme pour l’échange marchand ou son
« aspiration productiviste ». Plus encore, Généreux n’esquive pas la
question qui fâche : il y a bel et bien « une vérité » du
néolibéralisme. En effet, dans un contexte de compétition débridée, les
individus semblent n’avoir d’autre choix que de se conduire
effectivement comme cette anthropologie, fallacieuse, le prétend.
L’auteur s’en explique longuement, en s’appuyant non pas sur la théorie
marxiste (qui partagerait avec le néolibéralisme « 90% de son
patrimoine génétique ») du « reflet », mais sur les récentes recherche
en psychologie sur la résilience ainsi que sur les ressorts de la
servitude volontaire (notamment à partir de l’ouvrage de notre ami
Michel Terestchenko). Ainsi montre-t-il comment cette dissociété piège
les communautés humaines dans un gigantesque « dilemme du prisonnier ».
L’immense majorité d’entre nous aurait intérêt à une société
coopérative et solidaire, mais dans le contexte anxiogène qui est
désormais le nôtre, la réaction la plus rationnelle pour faire face et
y sauver son intégrité psychique, consiste à adopter ou à tolérer ce
modèle « dissociétal » de la compétition solitaire généralisée. On le voit, le diagnostic est sévère. Clinique même.
Cette « mutation anthropologique » majeure définit « la plus imminente
des catastrophes qui nous menace », cette « maladie sociale
dégénérative » dresse – au double sens du terme – les individus les uns
contre les autres et « altère les consciences en leur inculquant une
culture fausse mais auto-réalisatrice ». Fasciné par l’hégémonie de
l’idéologie néolibérale, Généreux semble parfois perdre confiance dans
les potentialités même de la nature humaine et des formes de solidarité
ordinaire dont il reconnaît pourtant, théoriquement, toute la portée.
Affirmer, avec raison, que la menace d’une dissociété ne résulte pas
d’un simple dysfonctionnement technique le conduit ainsi, à tort selon
nous, à poser que l’invention de politiques nouvelles ne saurait faire
face à ce stade suprême de l’aliénation qu’elle incarnerait. Suggérer
que « la majorité résiliente n’a pas besoin d’être convaincue par un
exposé détaillé des politiques alternatives », car ces solutions -
celles qui feraient le choix de la coopération - existeraient déjà et
que cette majorité souffrirait avant tout d’un sentiment d’impuissance
politique savamment entretenue, pour en conclure que « le seul moyen
dont dispose un citoyen pour reprendre la main » consiste à « adhérer
aux partis politiques et d’y mener la bataille interne pour changer la
ligne majoritaire », paraît un peu court. Car ce dont il s’agit, c’est
bien de rendre possible, réaliste – et agréable – ce pari du don et de
la coopération constitutif de la démocratie elle-même. Si ce pari
démocratique suppose, comme le soulignait John Dewey, une « foi dans la
nature humaine », totalement étrangère à l’anthropologie néolibérale,
cette foi ne peut-elle être ravivée seulement d’en haut, par une
croisade contre-hégémonique menée à partir de nos seules vieilles
églises partisanes ? Rien n’est moins sûr. S’il y a bien une contradiction entre ce nous tenons
pour vrai dans nos relations interpersonnelles, dans l’espace de la
socialité primaire - le primat de la solidarité, de la coopération et
du don - et ce que nous tolérons ou même valorisons dans la vie
sociale, dans l’espace de la socialité secondaire - la compétition
généralisée -, n’est-ce pas en vertu de la structure même des jeux peu
coopératifs dans lesquels nous nous trouvons prisonniers et qui, en
quelque sorte, laissent en friche notre sens ordinaire – et naturel –
de la solidarité ? La professionnalisation outrancière de la démocratie
représentative, un néo-corporatisme étroit, une division du travail
anomique, la bureaucratisation et la marchandisation de la solidarité
etc. ne ferment-ils pas, pratiquement, tout horizon au déploiement de
cet « appât du don » (Jacques Godbout) qui caractérisent les homo non-oeconomicus
que nous sommes aussi ? Dés lors, plutôt que de privilégier la seule
lutte idéologique et partisane, cette politique de la coopération ne
suppose-t-elle pas davantage de subvertir, pratiquement, la structure
de ces jeux non-coopératifs, d’ouvrir d’autres espaces de jeux et de
valoriser toutes les expérimentations sociales qui réussissent, elles,
à faire un usage efficace de cette force productive que constitue la
solidarité ? La riche analyse de Jacques Généreux nous invite ainsi
à prolonger davantage un autre aspect de la tradition socialiste avec
laquelle l’auteur appelle à renouer. Cette dimension indissociablement
morale et expérimentale, si chère tant à Pierre Leroux, Benoît Malon
qu’à Marcel Mauss, qui aujourd’hui encore nous rappellent que l’idéal
socialiste est moins un dogme qu’une morale pratique de la solidarité
et de l’association, et la politique réformiste moins un renoncement
qu’une expérimentation constante et pluraliste.
Philippe Chanial - Revue du MAUSS permanente (www.journaldumauss.com)
24 Avril 2007